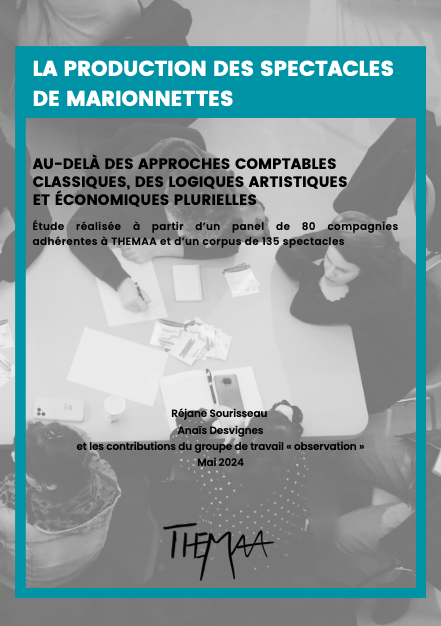Comité régional des professions du spectacle en Occitanie
Le Coreps Occitanie est l'instance de dialogue social régionale du secteur du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Il a pour objet d'instaurer un lien permanent de dialogue social, de consultation, de concertation, de réflexion et de proposition pour l'Etat, les Collectivités Territoriales, les partenaires sociaux et les organismes sociaux et professionnels. S'inscri...
- les métiers
- Découvrir les métiers
- du spectacle vivant,
- du cinéma et de l'audiovisuel
- par filière de production,
- par centre d'intérêt
- et famille de métiers
- ou par accès direct aux fiches
- Voir
- la formation professionnelle en pratique
- Employeurs ou salariés :
- quels dispositifs mobiliser
- par projet ou situation d'emploi ?
- Toutes les réponses à vos questions
- VOIR
- Travail Sécurité
Réglementation - Employeurs ou salariés
- ce que vous devez savoir en
- matière de réglementation
- de santé au travail,
- obligations, droits
- prévention des risques...
- VOIR